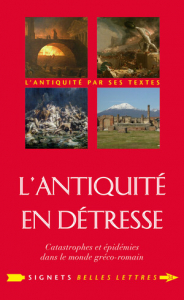
Voici, en exclusivité, l'entretien entre Jean-Louis Poirier et Emanuela Guidoboni qui ouvre le Signet L'Antiquité en détresse, tout juste paru aux Belles Lettres. Emanuela Guidoboni est historienne. Présidente et responsable scientifique de la SGA (Storia Geofisica Ambiente [Histoire, Géophysique et Environnement]) à Bologne, de 1983 à 2007, elle coordonne depuis 2010 les activités multidisciplinaires de l’EEDIS [Centro euro-mediterraneo di documentazione Eventi estremi e disastri].
JEAN-LOUIS POIRIER – Je voudrais d’abord que vous nous parliez de vous. Vous êtes historienne de la sismicité. Pouvez-vous nous expliquer, alors, comment vous en êtes venue à développer deux disciplines qui, en elles-mêmes, sont très éloignées, et dont chacune suppose des savoirs très différents, en particulier dans leur méthode ?
EMANUELA GUIDOBONI – L’histoire et la sismologie ont des statuts disciplinaires différents et relèvent de deux cultures, l’humaniste et la scientifique, qui – comme le remarquait C. P. Snow au milieu du XXe siècle – non seulement s’ignorent, mais d’ordinaire se détestent. Au contraire, dans le cas des tremblements de terre, entre l’histoire et la sismologie (et j’ajouterai la géologie), il existe une solidarité désormais de longue date.
L’histoire travaille aux fins de connaître le passé, elle en utilise le vocabulaire et les sources écrites, elle connaît les langues anciennes et les contextes culturels, elle peut décrire les changements des territoires et des villes. Les tremblements de terre sont des événements destructeurs qui ont laissé de nombreuses traces dans les pays de culture écrite ancienne.
La sismologie, qui s’appuie sur la géophysique, se sert des données enregistrées par les instruments, et donc des nombres, pour étudier les tremblements de terre au moment où ils se produisent. Grâce à ses appareils, la sismologie décrit les tremblements de terre au moment où ils ont lieu, calcule la profondeur d’où ils partent, détermine la valeur de l’énergie libérée, précise la chronologie du phénomène, enregistre l’accélération des sols engendrée par les ondes sismiques. Il faut préciser que les données des sismographes ne sont utilisables que pour les quatre-vingts dernières années, ce qui est trop peu pour connaître les caractéristiques sismiques d’une région. Mais de toute façon, réduite à ses instruments, la sismologie ne peut connaître et évaluer les effets des tremblements de terre en surface, autrement dit leur impact sur le monde habité : on a besoin de l’observation humaine pour faire la typologie de leurs effets, et c’est pour cela que, depuis la fin du XIXe siècle, on a élaboré les échelles d’intensité, à la suite de celle de Mercalli (1873).
C’est donc le facteur temps qui intervient dans ce secteur de recherche et fait de l’histoire un moyen de connaissance extraordinaire, je dirais volontiers indispensable, pour la sismologie, en particulier pour cette région qui s’occupe des structures sismogéniques et qui parle le langage de la géologie.
C’est d’après ces principes que, depuis quelques années, les recherches sur les tremblements de terre du passé se sont structurées en une discipline nouvelle, la sismologie historique, qui utilise la méthode historique pour répondre à certaines questions de la sismologie que l’on peut en gros résumer en trois adverbes : quand, où, comment s’est produit un tremblement de terre. Mais l’histoire, comme on sait, n’est pas sans complexité, et sur ce point sont apparus beaucoup de détails inattendus de la sismologie, mais se sont ouvertes aussi de nouvelles voies, intéressantes, pour l’histoire de l’économie, de l’urbanisme, des systèmes d’habitat, et des idées.
Dans les pays comme l’Italie, où des tremblements de terre de forte intensité se produisent avec une fréquence notable – nous avons un désastre sismique tous les quatre ou cinq ans –, je dirais qu’il est presque inexplicable que les historiens, à de rares exceptions près, ne s’occupent pas de l’histoire des tremblements de terre, et que les livres d’histoire continuent à ignorer cet aspect de notre environnement qui a tant marqué, et si durement, l’histoire de notre pays, et qui continue aujourd’hui, mais qui constitue aussi une menace pour la conservation de notre patrimoine culturel. À chaque tremblement de terre de quelque importance, c’est une église ou un palais qui s’en vont, et qui ne seront jamais reconstruits.
En ce qui concerne ce qui me motive particulièrement à ces recherches, je peux dire que je suis de formation une historienne du Moyen Âge : voilà une période de mille ans qui m’a préparée à affronter le temps long, et à dialoguer aussi bien avec les antiquisants qu’avec les spécialistes des temps modernes. J’ai été l’élève d’un grand médiéviste, Vito Fumagalli, et d’un géographe historique d’importance, Lucio Gambi : ces deux maîtres m’ont énormément donné, c’est auprès d’eux que j’ai appris à interroger les sources avec des approches nouvelles, sans me soucier de suivre des parcours académiques déjà tracés.
Je voudrais vous demander aussi de quels éléments vous disposez pour faire l’histoire des séismes ou des raz de marée : vous en tenez-vous aux témoignages littéraires et aux inscriptions ?
La sismologie historique est une histoire au temps long, du fait de ses propres objectifs, parce qu’il est nécessaire d’accéder à une fenêtre de temps aussi large que possible. Ainsi les recherches respectent dans leur méthode et dans leur interprétation des sources les périodisations mêmes de la recherche en histoire (qu’elle soit ancienne, médiévale, moderne et contemporaine), périodisations qui nécessitent des approches et des compétences spécifiques, car les contextes historiques et culturels, comme les sources, sont différents. Pour répondre plus spécifiquement à votre question, et ne nous attachant ici qu’à l’Antiquité, je peux dire que la gamme de sources utilisée pour le Catalogue des tremblements de terre de la zone Italie et Méditerranée du VIIIe siècle av. J.-C. au Ve siècle apr. J.-C. est très large : elle va des textes des écrivains et des historiens à ceux des poètes, des philosophes de la nature, des lexicographes ; pour la période de l’Antiquité tardive, et pour toute la zone méditerranéenne, nous avons également utilisé les œuvres d’exégètes chrétiens, des lettres d’évêques, des homélies, souvent prononcées et puis écrites à l’abri des atteintes d’un tremblement de terre destructeur (on pense à la tradition des homélies attribuée à Jean Chrysostome, dans la Patristique grecque). C’est un vaste panorama de voix : souvenirs, réflexions, assertions, citations, chaque auteur ayant ses propres motivations pour mentionner, se souvenir ou décrire un tremblement de terre.
L’historien-sismologue doit pour ainsi dire décoder ces témoignages pour recueillir un élément descriptif permettant de dater et d’évaluer le phénomène naturel et son impact. À ce vaste corpus, varié et précieux, de textes du monde antique, de l’antiquité tardive et byzantine – arrivés jusqu’à nous, rescapés du naufrage du temps – s’ajoutent les inscriptions gravées sur la pierre ou griffonnées, opportunément étudiées et systématiquement recueillies dans des corpus spécifiques. Les inscriptions mentionnent parfois des références directes à des tremblements de terre ayant eu lieu, mais le plus souvent, seules les dates de reconstruction ou de restauration sont indiquées. C’est un domaine d’analyse très pointu, qui pourrait fournir encore des informations nouvelles, provenant de découvertes occasionnelles d’épigraphes (ou de parties d’épigraphes) dans des fouilles archéologiques. Les épigraphistes sont de précieux alliés des sismologues historiques.
En Italie, à partir du bas Moyen Âge, le patrimoine archivistique est très bien conservé et réparti sur le territoire : cela a permis de mener des recherches très détaillées sur la documentation directement produite par les sociétés atteintes. De plus, la décentralisation du pouvoir dans les anciens États italiens d’avant l’Unité (1861), fournit à la recherche historique une gamme extraordinairement variée de sources (administratives, fiscales, juridiques, ecclésiastiques, etc.), sur les dommages causés par des catastrophes naturelles au patrimoine urbain et aux moyens de production. Les sources peuvent non seulement décrire de diverses manières et de différents points de vue les impacts subis, mais aussi faire apparaître les interventions mises en œuvre pour remédier à leurs effets. Outre cela, on trouve des traités, des rapports, des lettres qui font état d’idées, de théories, d’opinions, de discussions sur les causes des phénomènes naturels dommageables.
Il y a là un monde très riche en informations et en réflexions. Toutefois, ces textes ne peuvent être exploités sans une explication rigoureuse et libre de toute perspective étroitement spécialisée.
Existe-t-il une branche de l’archéologie qui s’y consacre, et avec des méthodes spécifiques, et lesquelles ? Pouvez-vous nous donner quelques exemples de vos recherches et de vos problèmes de méthode ?
L’archéosismologie est la partie de l’archéologie qui traite des traces laissées par les tremblements de terre. Les termes archéosismologie et archéologie sismique sont utilisés depuis plusieurs décennies, mais le thème de recherche « tremblement de terre », en archéologie, date au moins de la seconde moitié du XIXe siècle. Ce thème a retenu l’attention dans la zone méditerranéenne soit en raison des caractéristiques sismiques de cette zone, soit du fait de la présence importante de vestiges antiques. Depuis le début des années 1970, il y a eu une augmentation significative de l’intérêt. Ce tournant a fait de l’archéosismologie pratiquement une partie de la sismologie, contiguë de la sismologie historique en termes conceptuels, pour ainsi dire comme un prolongement de celle-ci. Malgré cela, la littérature archéologique sur les tremblements de terre s’est développée dans une certaine indifférence quant à la méthode et aux objectifs, mais les travaux exigeants et pertinents n’ont pas manqué.
Le modèle conceptuel qui explique l’intérêt de la sismologie historique pour l’archéologie est une fois de plus lié à l’échelle du temps. S’agissant des périodes ou les zones pour lesquelles il n’y a pas de sources écrites, l’archéologie peut indiquer les traces des tremblements de terre : effondrements primaires (non dus à des effondrements gravitationnels en raison de l’abandon ou de la dégradation des bâtiments), mais aussi instabilité, dislocations des matériaux, anciennes réparations, rétrécissement du périmètre urbain entraîné par la dépopulation, réutilisation de pièces conservées, etc. Il n’est pas rare que, dans la région méditerranéenne, des squelettes humains ou animaux aient aussi été trouvés sous les effondrements (en Italie, en Grèce, à Chypre, en Crète), signe que l’effondrement s’est produit soudainement. Il y a là un domaine très riche et de grand intérêt sur lequel il existe maintenant une littérature scientifique internationale considérable, bien que d’importance et de qualité inégales.
L’importance pour la sismologie historique des traces archéologiques des tremblements de terre est qu’elles sont précisément localisées. En revanche, la datation de ces traces reste plus problématique.
Comme on le sait, en archéologie, la datation est toujours et seulement un espace de temps, identifié par la stratigraphie de la fouille par la succession de l’avant et de l’après. Dans la plupart des cas, il suffit de disposer d’une fourchette de temps qui témoigne de toute façon d’une activité sismique dans une période et un lieu donnés. Mais quand les archéologues cherchent la datation absolue d’une trace sismique en tentant de la déduire d’une source écrite, alors nous sommes en difficulté. En fait, la corrélation entre les données archéologiques concernant les effets locaux d’un tremblement de terre X, et la mention d’un tremblement de terre Y contenue dans un texte, a souvent été à l’origine d’erreurs qui ont ensuite pénétré dans la littérature historiographique, par une sorte de jeu de miroirs. Ce n’est que dans de rares cas qu’il est possible de dater un tremblement de terre archéologique au moyen de sources écrites : dans ce cas est le tremblement de terre de 62 apr. J.-C., visible dans les fouilles de Pompéi et d’Herculanum, et arrivé dix-sept ans avant l’éruption du Vésuve, qui a enseveli la ville sous 6 à 8 m de matières volcaniques.
Le système mixte de datation, que j’ai souvent appelé « de type circulaire » peut inventer des tremblements de terre exagérément étendus en agrégeant à une datation absolue des traces sismiques différentes, la plupart du temps éloignées l’une de l’autre et dans le temps. Le cas le plus célèbre de cette extension indue des effets est celui du tremblement de terre et du tsunami du 21 juillet 365, qui a impliqué dans une discussion, presque un affrontement, trois générations de savants. Son universalité, facilement explicable du point de vue des sources, s’est consolidée en archéologie, à strictement parler, puis a été reprise dans une partie de l’historiographie. On peut ainsi priver de témoignages d’activité sismique d’autres régions, pour lesquelles nous n’avons que peu ou pas d’informations.
Il existe également de nombreux lieux archéologiques qui sont de véritables rébus du point de vue sismique, pour lesquels il n’y a pas de solutions certaines. Parfois, il faut accepter que la recherche soit logée à l’enseigne de l’incertitude.
Diriez-vous qu’il y a eu une évolution, ou qu’il y a des différences entre les tremblements de terre de l’Antiquité et ceux d’aujourd’hui ? Les zones sismiques à risque sont-elles les mêmes ? Leur nature est-elle la même ? L’approche historique a-t-elle la même importance en ce qui concerne les autres phénomènes ? les phénomènes volcaniques par exemple ?
Comme je l’ai mentionné précédemment, les forces sismiques, comparées selon les différentes échelles du temps géologique et historique, peuvent être considérées comme « stables » : mais cela ne signifie pas que nous pouvons avoir une représentation précise de la sismicité du passé et nous contenter de comparer tout court nos données actuelles avec celles issues de la recherche historique, pour diverses raisons. Nous devons donc nous demander quelle est la représentation de la sismicité capable d’être produite par la sismologie historique, et quel rapport elle a avec la sismicité réelle.
Tout d’abord, le monde était beaucoup moins habité, et même de forts tremblements de terre ont pu ne laisser aucune trace décelable pour nous aujourd’hui ; mais à l’inverse, des tremblements de terre peuvent avoir eu lieu dans des endroits où personne n’était en mesure de ressentir l’événement, parce qu’il s’agissait de zones très peu ou pas du tout habitées, ou dépourvues de gens à même de laisser des souvenirs écrits. Et si quelqu’un a écrit, il faut aussi que les témoignages soient parvenus jusqu’à nous. Si l’on me passe cette comparaison, nous pouvons considérer ces témoignages comme des sismogrammes lointains, pour lesquels nous connaissons peu ou mal le fonctionnement de l’« instrument » qui les a produits.
En dehors des situations influencées par des événements historiques, nous pouvons affirmer que la sismicité naturelle était très similaire à notre sismicité actuelle, ce qui est utile pour les prévisions à moyen et à long terme. Toutefois, nous ne pouvons pas oublier que nous travaillons aujourd’hui sur des séries historiques défectueuses, autrement dit, nous sommes conscients d’avoir « perdu » de nombreux tremblements de terre.
Le problème de l’utilisation de ces données pour faire une sorte de prévision à moyen terme sur la base de la fréquence n’est ni simple ni évident pour la pratique statistique. En fait, plutôt que de peser ces incertitudes dans des calculs de probabilité, il est préférable d’utiliser uniquement les données relatives aux siècles qui sont considérés comme « complètes », eu égard aux niveaux de magnitude les plus élevés, c’est-à-dire pour l’Italie, les trois ou quatre derniers siècles. C’est un problème multidisciplinaire peu courant, qui reste encore à résoudre complètement, puisque en réalité, on perd de cette façon des informations importantes (à l’inverse, les géologues utilisent toutes les données, y compris les plus éloignées).
Il y a aussi des tremblements de terre rares, à savoir avec des périodes de récurrence de plus de deux mille ans, dont il est très probable qu’ils ne sont pas entrés dans notre fenêtre temporelle d’observation, si bien que nous ne savons pas où et quand ils pourraient nous frapper à nouveau. Pour dépasser cette fragmentation apparente, on a mis au point en Italie un modèle structurel fondé sur des bases historiques et géologiques d’une grande pertinence scientifique.
Ce modèle identifie les zones sismogènes actives et vaut donc aussi pour l’avenir. Si nous ne pouvons pas prédire de façon déterministe « quand » se produira le prochain tremblement de terre majeur, néanmoins nous pouvons désormais savoir clairement « où » il se produira, et cela forme déjà une grande partie du rébus, parce que les zones historiques touchées sont toujours celles-ci, ce qui est (ou plutôt serait) un point de départ pour éviter les dommages.
Le monde antique se pose le problème de la prévision, en recherchant des signes précurseurs, que nous dirions aujourd’hui à court et très court terme.
La tradition qui nous est transmise par Pline et par Cicéron (De divinatione, I, 501, 12) nous indique seulement deux prévisions réalisées : celle d’Anaximandre de Milet (VIe siècle av. J.-C.), l’élève de Thalès, qui a pu prédire un tremblement de terre à Sparte, et celle de Phérécyde de Syros (VIe siècle avant J.-C.), le maître de Pythagore.
L’Antiquité abonde en événements de très grande ampleur si l’on en croit les témoins, même s’il y a des polémiques à ce sujet, certains récits étant vraisemblablement des fictions. Qu’en pensez-vous ?
Il n’est pas facile de comprendre le point de vue de nombreux textes du monde antique et médiéval, très éloignés de notre sensibilité. Je pense qu’à l’origine de nombreux « récits » – qui ne sont pas purement mythologiques ou symboliques, dans une région où tout se complique par après – il y a un phénomène naturel réel, transfiguré et rendu presque méconnaissable. Et il est possible que, quelquefois, il y ait des choses fausses dans la description d’événements naturels désatreux ou de véritables catastrophes, mais je pense qu’elles ne sont pas entièrement intentionnelles. Je pense qu’il est beaucoup plus probable que ce qui nous semble absurde ou faux soit l’effet de dilatations, de distorsions ou d’exagérations, mais ne soit pas à proprement parler faux. La distance entre des cadres cognitifs si éloignés dans le temps et notre présent, appartenant à l’univers de l’observation scientifique et de la précision, peut faire donner à certaines descriptions l’apparence de la fausseté. Il dépend de la minutie de l’historien de décoder ces « sismogrammes » parfois mystérieux, pour en comprendre la déformation sous-jacente et le « bruit » de fond.
On trouve, à ce propos, un exemple intéressant et révélateur de cette façon de procéder dans les explications antiques, où sont utilisés à la fois la théorie, l’observation de la réalité et des éléments hypothétiques, relevant de l’imagination, et donc étrangers à la vérité : c’est ce qui se passe concernant la séparation de la Sicile du continent en raison d’un fort tremblement de terre (ou de plusieurs), interprétation transmise par toute la tradition et dont parle aussi Strabon, parmi d’autres. À mon avis, c’est un cas qui pourrait être défini comme relevant d’une explication convergente. On croyait que l’absence, dans le détroit, d’une issue pour évacuer les vents souterrains avait été la cause de l’activité sismique qui éloigna jadis la Sicile du continent, la Sicile mettant ainsi en communication les mers Ionienne et Tyrrhénienne. Certains auteurs anciens pensaient que les tremblements de terre avaient érodé un cordon de terre préexistant, et que cela s’était produit sur beaucoup de temps.
La théorie des vents souterrains devait expliquer l’action sismique modificatrice, mais elle entrait dans une contradiction théorique avec les vents extérieurs, c’est-à-dire avec le régime fort, stable et bien connu des vents du détroit. Donc, pour s’accorder avec la théorie, on en vint à penser que la sismicité causée par les vents souterrains avait créé des ouvertures dans le sol, permettant de faire sortir les vents à la surface. Les vents forts persistants servirent alors de toile de fond aux monstres mythiques Charybde (un tourbillon) et Scylla (un écueil), qui menaçaient les marins : personnification de la difficulté qu’il y avait à franchir le détroit (aujourd’hui encore on parle d’être, au sens figuré, « entre Charybde et Scylla »). Cette difficulté était due non pas aux vents, mais au brusque changement des courants, toujours irréguliers à cet endroit, parce que c’est le point de contact des deux bassins marins (Ionien et Tyrrhénien).
Dans le récit ancien, qui peut sembler très naïf, il existe une intuition fondamentale vraie, encore aujourd’hui, à savoir que la sismicité est une force dynamique qui façonne les territoires. Nous savons que la Sicile s’éloigne progressivement de la Calabre, comme en témoignent les données géophysiques et surtout les observations géodésiques. Cependant, il n’y a jamais eu de « cordon » de terre entre les deux rives de la Sicile et la Calabre, sans compter que les Anciens ne pouvaient pas imaginer les temps en millions d’années dans lesquels se sont formées les côtes ni les importantes variations du niveau de la mer (supérieures à 120 m). Ici, les côtes sous-marines ressemblent à la partie émergée du détroit et présentent donc des pentes très abruptes atteignant une profondeur de plus de 1 000 m dans la partie méridionale du détroit.
Aujourd’hui, nous connaissons la cause géologique de ce mouvement qui sépare la Sicile du continent, selon une direction presque exactement est-ouest, qui s’oppose en effet à la poussée nordnord-ouest de la plaque africaine, dont fait également partie la Sicile, par rapport à la plaque euro-asiatique.
Plusieurs campagnes océanographiques menées dans la région ont mis en évidence un système de failles étendu, non loin des côtes. Et il y a dans le détroit une ligne de faille active et puissante, capable de générer des tremblements de terre de magnitude 7, comme celui de 1908. À partir des données historicoarchéologiques nous avons connaissance au moins de l’un de ses prédécesseurs, à savoir le tremblement de terre de 362-363 apr. J.-C. Nous connaissons donc deux événements résultant de la même faille et compris dans notre fenêtre historique d’observation : c’est de la chance, mais ce n’est pas le seul cas dans la région méditerranéenne. Cela fait voir que le temps de récurrence d’un tremblement de terre fort produit par cette faille est d’environ mille cinq cents ans, période comparable à la vitesse d’extension du détroit, telle qu’elle ressort des données géodésiques. Je me suis demandé si la faible fréquence des tremblements de terre forts dans le détroit, qui est claire pour nous aujourd’hui, n’était pas, d’une manière ou d’une autre, connue dans les temps anciens et n’avait pas contribué à renforcer la théorie des vents souterrains « libérés ».
Y a-t-il selon vous des différences essentielles entre les diverses catastrophes naturelles de l’Antiquité et celles du même genre que nous connaissons aujourd’hui ? La planète vous semble-t-elle plus menacée aujourd’hui, ou bien l’histoire vous conduit-elle à penser que rien ne change ?
À mon avis, il n’y a pas de différences essentielles dans les catastrophes naturelles, en ce sens qu’elles sont toutes reconnaissables dans nos catégories scientifiques actuelles. Ce qui change, et même de manière très claire, c’est la perception différente du phénomène et son impact, c’est-à-dire les effets produits, parce que l’environnement habité et l’environnement naturel se présentent aujourd’hui dans des conditions tout à fait différentes de celles du monde antique. Je pense que le monde d’aujourd’hui est plus menacé par des facteurs anthropiques que par des événements naturels, même si ces derniers peuvent devenir des catastrophes majeures en raison des morts et des dommages dus avant tout à certains facteurs :
– l’augmentation de l’échelle démographique globale : nous sommes 7 milliards, contre une estimation d’environ 160 millions pour la période de l’Antiquité ;
– l’augmentation du niveau de vulnérabilité des constructions dans les zones les plus habitées de la planète
– qu’on pense aux mégalopoles du Proche et de l’Extrême-Orient, dans des zones très sismiques. Les experts nous disent qu’au niveau mondial, la vulnérabilité des bâtiments s’élève considérablement à raison de l’augmentation de la pauvreté, qui détermine la croissance des grandes banlieues urbaines, où se concentrent des ensembles de bâtiments de très mauvaise qualité ;
– la présence de nombreuses industries à haut risque (centrales nucléaires, industries chimiques, etc.) dans des zones sismiques notoires.
Les systèmes de logement actuels – y compris les bâtiments, les routes, les connexions, etc., la dépendance à l’électricité ou à un seul combustible – sont complexes et vulnérables, de sorte que leur effondrement éventuel dû à un événement naturel extrême peut entraîner une série de conséquences beaucoup plus graves que celles qui pouvaient arriver dans le monde antique, y compris dans le cas de phénomènes du même type et de la même intensité.
Que pensez-vous des réactions humaines face à ces terribles évènements ? Faisons-nous mieux aujourd’hui, ou avons-nous des leçons à prendre de la part des Anciens ?
Il y a des réactions humaines subjectives, que nous pourrions dire « élémentaires », qui sont communes à des sociétés et à des cultures même très éloignées dans le temps et dans l’espace géographique, telles que la peur, la fuite, le désarroi face à la perte de vies liées à la sienne propre ou à la perte de ses biens. Aujourd’hui, comme par le passé, venir après une catastrophe, c’est comme se trouver face à la fin de son propre monde. Il est nécessaire de compter sur sa propre capacité de réaction : cela a été vrai dans le passé et l’est encore aujourd’hui.
Ensuite, il y a les réactions qui dépendent de la culture de l’époque et du contexte historique et social. Nous pouvons nous demander, par exemple, si la pitié et la compassion, telles que nous les entendons aujourd’hui, étaient des sentiments répandus et partagés dans le monde antique et au Moyen Âge. Les sources font voir que les cités méditerranéennes sinistrées par les tremblements de terre ont souvent été attaquées et pillées, les survivants volés ou réduits en esclavage par les villes voisines. S’emparer des objets de valeur et du mobilier en les extrayant des décombres était une pratique répandue.
Aujourd’hui, nous sommes solidaires de ceux qui ont subi un désastre, nous sommes inclinés à faire preuve de sympathie, au sens étymologique du terme, à l’égard de ceux qui subissent un événement naturel terrible et se trouvent en difficulté. Les secours organisés par les gouvernements représentent une réponse sociale en accord avec les sentiments individuels répandus dans la société. La solidarité est un sentiment en un sens récent, fille des États nation, du christianisme et du romantisme, parce qu’il repose sur l’initiative individuelle (tout le monde, en tant qu’individu, donne ou fait). Ce sentiment n’existait pas dans le monde antique et médiéval.
Un autre aspect sur lequel nous pourrions réfléchir, et qui marque une distance décisive entre les situations actuelles de désastre et celles du passé, ce sont les reconstructions : à part la générosité impériale, ou les donations de personnes privées avec des objectifs politiques, ou un protecteur puissant, la reconstruction était un problème avant tout individuel et familial. La charge pouvait être si lourde, ou l’événement jugé si défavorable, en un sens superstitieux, que l’on était poussé à abandonner un site. Cela a été vrai non seulement dans le monde antique et dans l’Antiquité tardive, mais aussi pendant tout le Moyen Âge et dans les temps modernes, et je dirais, sauf exception rare, jusqu’au début du XXe siècle : ce n’est que depuis lors que les gouvernements centraux sont plus ou moins intervenus dans la reconstruction, avec un financement public substantiel pour reconstruire même les habitations privées. En Italie, c’est ce qui est arrivé à partir de 1909, après le terrible désastre du tremblement de terre du détroit de Messine (de magnitude 7, avec plus de 90 000 morts).
Aujourd’hui, dans la culture italienne répandue, la reconstruction d’un lieu endommagé aux frais de la communauté nationale est ressentie comme un droit, même s’il n’y a aucune loi qui le prévoit ou le réglemente. Notre Constitution indique les principes mais ne règle pas les procédures, qui sont appréciées dans chaque cas. Les reconstructions ont été et sont toujours pour l’Italie une charge économique considérable, une occasion de conflits sociaux et de disputes économiques et politiques, qui peuvent durer des décennies. La prévention n’est pas mise en œuvre sur une grande échelle en ce qui concerne les risques naturels, et il y aura encore des désastres. Ils appartiennent à une histoire millénaire qui suit son cours.
De ce point de vue, je ne pense pas que l’histoire soit maîtresse de vie, mais plutôt dispensatrice d’informations précieuses pour connaître et évaluer, peut-être pour modifier, notre relation à la nature. Dans le présent, il y a beaucoup de traces du passé, mais il y a aussi beaucoup de traces de l’avenir, pour peu que nous voulions les voir. Et pourtant, nous sommes comme pris au piège dans une sorte de présent étendu : nous avons, par exemple, les moyens technologiques de savoir à tout instant où et quand se produisent des événements naturels catastrophiques, mais nous n’avons pas une culture de l’avenir qui nous pousserait à améliorer vraiment les réponses sociales apportées aux catastrophes naturelles. Nous avons une bonne géographie des zones sismiques, nous savons évaluer la probabilité de retour des événements destructeurs, mais la culture italienne commune considère encore les tremblements de terre comme des événements occasionnels, d’une manière qui n’est pas différente de celle des siècles passés, quand on croyait que seuls les saints, les miracles, ou simplement la chance, pourraient mettre à l’abri de ce genre de désastres. Mais il est vrai que quelque chose est en train de changer, lentement.
Les événements naturels extrêmes ont été un grand risque du monde antique, facteur de mort et de destruction, comme les guerres et les grandes épidémies. Nous n’avons rien résolu ni en ce qui concerne les risques naturels, ni en ce qui concerne les guerres, ni en ce qui concerne l’éventualité de pandémies induites. Les risques sont donc accrus, je dirais qu’ils se sont additionnés. De nouveaux risques anthropiques sont apparus, d’autres sont à l’horizon. Pouvons-nous nous considérer comme des « nains sur les épaules des géants », c’est-à-dire voir plus et mieux, grâce à ceux qui nous ont précédés ? J’ai beaucoup de doutes, parce que la sagesse nous fait défaut pour en tirer les conséquences.
Propos recueillis et traduits de l’italien par Jean-Louis Poirier